source : http://journals.openedition.org/paysage/16248
Mounia Bennani, « Le rôle fondateur du paysage dans la création des villes coloniales marocaines », Projets de paysage [En ligne], 7 | 2012, mis en ligne le 04 janvier 2012, consulté le 04 juin 2023. URL : ; DOI : https://doi.org/10.4000/paysage.16248
En avril 2010 le titre de « Ville verte » fut attribué à Rabat, capitale du Maroc. Ce statut de ville verdoyante remonte à la création de la ville moderne coloniale dans les années 1920

RÉSUMÉ
En avril 2010, lors de la célébration du 40e anniversaire de la Journée de la terre, le titre de « Ville verte » fut attribué à Rabat, capitale du Maroc. Ce statut de ville verdoyante remonte à la création de la ville moderne coloniale dans les années 1920, une « ville-paysage » qui trouve ses fondements dans son patrimoine naturel et historique. Rabat et Marrakech furent aménagées comme des villes-jardins modèles à l’époque du protectorat français, mais suivant des principes différents. À Rabat, le système d’espaces libres fut conçu de toutes pièces par Jean Claude Nicolas Forestier en 1913 à partir d’un « plan spécial des espaces libres » ; alors qu’à Marrakech, le réseau de parcs et de jardins préexistait, l’essentiel de l’action urbanistique du protectorat fut de préserver le patrimoine paysager existant et de l’intégrer à la planification des nouveaux quartiers européens. Près d’un siècle plus tard, le patrimoine paysager de Rabat est au cœur des préoccupations : les jardins publics créés dans les années 1920, qui sont aujourd’hui les poumons verts de la ville, ont été classés sur la liste du patrimoine national, l’histoire du « système de parc » expérimenté à Rabat est enseignée dans les écoles d’architecture et le plan d’aménagement de Rabat prévoit d’augmenter le ratio actuel de 20 m² d’espace vert par habitant à 30 m².
PREMIÈRE PAGE
Le paysagiste Jean Claude Nicolas Forestier proposa au résident général de mettre en application le concept de « système de parcs » qu’il venait de théoriser en 1906 à travers son ouvrage Grandes Villes et Systèmes de parcs
L’objet du présent article est de montrer l’importance qui fut accordée aux espaces libres dans la planification des nouvelles villes marocaines au cours du protectorat français (1912-1956).
Dès l’établissement du protectorat, le premier résident général de la France au Maroc, le maréchal Hubert Lyautey (1854-1934), lança le défit de créer des villes modèles, symboles de modernité et de progrès, à l’image de la puissance coloniale française ; en pleine guerre 1914-1918, il s’agissait d’un véritable « geste de guerre ». Pour réaliser son programme urbanistique, le résident Lyautey se tourna vers la France et plus précisément vers le Musée social qui tentait de faire valoir l’obligation de plans d’aménagement et d’extension pour les grandes villes françaises. Membre du Musée social et conservateur des promenades de Paris, le paysagiste Jean Claude Nicolas Forestier proposa au résident général de mettre en application le concept de « système de parcs » qu’il venait de théoriser en 1906 à travers son ouvrage Grandes Villes et Systèmes de parcs. Cette théorie, restée sans application en France, consistait à planifier les nouvelles agglomérations et à orienter leur développement à travers un réseau hiérarchisé et continu d’espaces libres, allant du jardin public aux ceintures vertes périurbaines.
En 1913, appelé par Lyautey, Forestier se rendit en mission quelques mois au Maroc pour dresser un « rapport des réserves à constituer au-dedans et aux abords des villes capitales du Maroc… ». Dans ce rapport, Forestier proposa un ensemble de prescriptions à suivre afin de mettre en œuvre le principe de système de parcs dans chacune des villes impériales marocaines. Pour mettre en application les prescriptions de Forestier, Lyautey, sur les conseils du paysagiste, fit venir l’architecte Henri Prost.
Dès leur arrivée au Maroc, en 1914, Prost et son équipe allaient établir des plans d’aménagement pour l’ensemble des villes marocaines. Toutes les nouvelles agglomérations allaient être conçues sur la base des principes urbanistiques imposés par le résident Lyautey, à savoir :
– la séparation de l’ancienne et de la nouvelle cité ;
– la création, à l’extérieur des médinas, d’une zone non aedificandi de protection militaire et d’hygiène ;
– la division de la nouvelle ville en quartiers différenciés (zoning).
En plus de ces principes, Henri Prost expérimentera le concept de « système de parcs » élaboré par Forestier. Pour bien comprendre comment les nouvelles agglomérations coloniales se sont construites à travers un système de parcs et de jardins, nous prendrons l’exemple de deux villes : Rabat – la capitale – et Marrakech, deux cités-jardins par excellence.
Rabat, le prototype de la ville-paysage des années 1920
Rabat, la veille du protectorat
Rabat se situe sur la Côte atlantique, à l’embouchure du fleuve Bou-Regreg, face à la ville de Salé qui occupe la rive opposée. Elle est naturellement délimitée au nord par l’océan, à l’est et au sud par la vallée du Bou-Regreg. Le relief ondulé lié aux cordons dunaires parallèles au littoral offre une succession de points hauts (belvédères) et de points bas. La situation géographique et la topographie du site seront déterminantes dans le choix de la répartition des espaces libres de la nouvelle agglomération.
En 1912, au moment de l’installation des premiers Français dans la capitale, la ville se concentrait dans deux noyaux urbains : la casbah des Oudaïas, ancien camp fortifié datant du ixe siècle, situé à l’embouchure du Bou-Regreg et la médina cantonnée dans son enceinte andalouse datant du xviie siècle. À l’extérieur de cette enceinte, quelques monuments ponctuaient le paysage : les ruines de la mosquée de la tour Hassan – sœur jumelle de la Ghiralda de Séville et de la Koutoubia de Marrakech – restée inachevée sous la dynastie des Almohades (xiie siècle), la mosquée Es-Sounna, le palais impérial, élevés au xviiie siècle, et ses jardins (l’Aguedal). Ces éléments étaient délimités par une seconde enceinte élevée au xiie siècle par les Almohades. Au-delà de ces remparts extérieurs, s’élevait, en belvédère sur la vallée du Bou-Regreg, les ruines du Chellah, ancienne nécropole mérinide du xiiie siècle. Le reste de l’espace situé entre l’enceinte extérieure et l’enceinte intérieure – qui entoure la médina – était occupé par des jardins, des vignes et des orangeraies.
Les prescriptions de Forestier pour la planification de la nouvelle ville
Dans son rapport rédigé en 1913, Forestier préconisait pour la future ville de Rabat un certain nombre de recommandations portant, d’une part, sur la protection des jardins existants et, d’autre part, sur la création de nouveaux espaces libres. En premier lieu, il demanda que l’on conserve les jardins et les plantations d’orangers situés autour de la médina, à l’intérieur de l’enceinte almohade, en créant, notamment, une zone verte non aedificandi à l’extérieur de l’enceinte andalouse. Au-delà des remparts extérieurs, il recommanda de créer, avant que la ville ne se développe, des réserves pour des jardins publics et pour des avenues promenades.
Parallèlement, il proposa de relier les différents quartiers par un réseau de communication combinant voies larges et rues plus étroites avec un dispositif de plantations adapté. Pour anticiper la croissance de la ville à moyen et à long terme, Forestier conseilla la création de zones vertes d’isolement à l’extérieur de l’enceinte almohade.
Lire la suite : https://journals.openedition.org/paysage/16248?lang=fr#tocto2n3
Mounia Bennani
Architecte paysagiste et docteur en géographie, elle est actuellement directrice gérante de l’agence de paysage MBpaysage au Maroc (www.mbpaysage.ma) et présidente fondatrice de l’Association des architectes paysagistes du Maroc (AAPM). Bennani_mounia[at]hotmail[dot]com
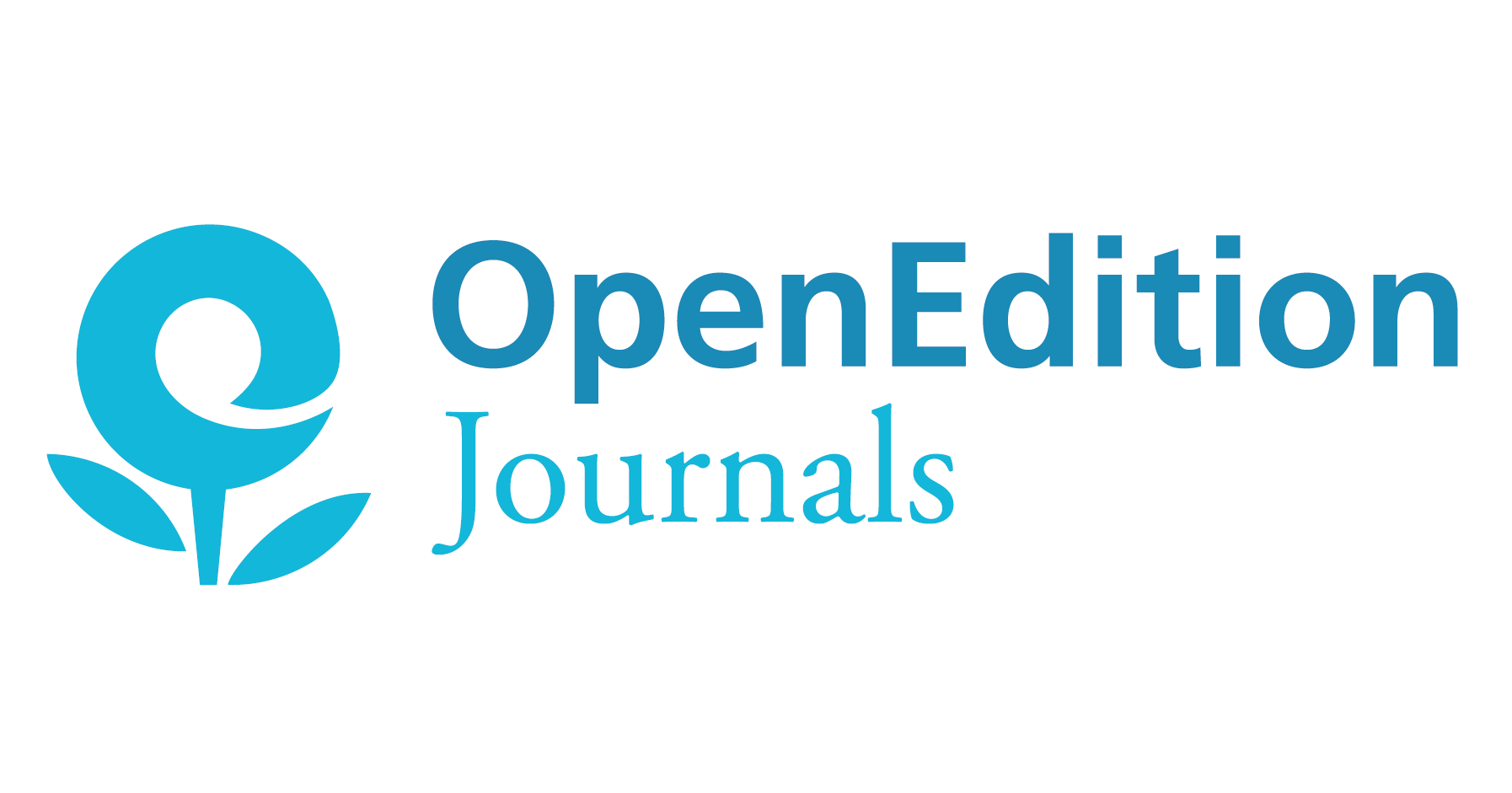

Laisser un commentaire