
Présentation de l’ouvrage
C’est de la culture savante, c’est-à-dire, latine, scolaire et universitaire qu’il s’agit ici. Telle qu’elle se définit aux XIIe et XIIIe siècles, sur la base d’un stock canonique d’« autorisés », cette culture a des contours précis et des limites assez étroites. Mais à l’intérieur de celles-ci, elle a élaboré des méthodes de travail intellectuel d’une grande rigueur. C’est aussi de l’école urbaine et de l’université qui prend sa suite au XIIIe siècle, qu’il sera question. Sans remettre ouvertement en cause le contrôle traditionnel de l’Église, les institutions d’enseignement s’affinent aux XIIe et XIIIe siècles et acquièrent leur autonomie, non sans attirer bientôt, d’ailleurs, l’attention du prince. […]
Référence électronique du chapitre
Verger, Jacques. « Chapitre VIII. Naissance de l’université de Paris (1200-1231) ». Culture, enseignement et société en Occident aux XIIe et XIIIe siècles, Presses universitaires de Rennes, 1999, https://doi.org/10.4000/books.pur.21367.

« L’université de Paris était reconnue comme une institution majeure de la Chrétienté médiévale, une autorité intellectuelle unanimement respectée, digne à la fois d’attirer à elles les meilleurs esprits de tout l’Occident et d’exercer à l’échelle de celui-ci une sorte de magistère doctrinal, en union étroite, évidemment, avec le Siège romain »
Chapitre VIII. Naissance de l’université de Paris (1200-1231)
Jacques Verger
p. 117-129. LARGES EXTRAITS
§ 1- L’apparition des premières universités, au tournant des xiie et xiiie siècles, est un moment capital de l’histoire culturelle de l’Occident médiéval. Nous avons rappelé au précédent chapitre de ce livre dans quel contexte s’était faite cette apparition. On aura compris qu’elle a comporté, par rapport à l’époque précédente, des éléments de continuité et des éléments de rupture. Les premiers sont à chercher du côté de la localisation urbaine, du contenu des enseignements, du rôle social dévolu aux hommes de savoir. Les seconds ont d’abord été d’ordre institutionnel. Même si des rapprochements s’imposent entre le système universitaire et d’autres formes contemporaines de vie associative et communautaire (confréries, métiers, communes), il reste que ce système était, dans le domaine des institutions éducatives, tout à fait nouveau et original, sans véritables précédents historiques ni en Occident, ni dans les mondes voisins (Byzance, Islam). Face à l’inadéquation des structures anciennes et à la confusion engendrée par la croissance de moins en moins contrôlée des écoles et des savoirs, le regroupement des maîtres et/ou des étudiants en communautés autonomes reconnues et protégées par les plus hautes autorités laïques et religieuses du temps, a permis tout à la fois des progrès considérables dans le domaine des méthodes de travail intellectuel et de la diffusion des connaissances et une insertion beaucoup plus efficace des gens de savoir dans la société de l’époque.
Les premières universités ont été peu nombreuses. Au milieu du xiiie siècle, on n’en comptait guère que sept ou huit vraiment actives : Bologne, Paris, Oxford, Cambridge, Montpellier, Salamanque, Naples, peut-être Padoue ou Verceil ; en 1300, il n’y avait encore vraisemblablement, en ajoutant aux précédents le studium de la Curie romaine, Toulouse, Lisbonne et Lerida, qu’une douzaine de studia generalia (de taille d’ailleurs très inégale) fonctionnant effectivement en Occident. Beaucoup d’autres centres scolaires, en déclin, avaient déjà perdu la qualité d’universités (comme Palencia, Arezzo ou Sienne) ou n’y étaient jamais parvenus (comme Salerne). Quelques autres au contraire, en essor, n’avaient pas encore obtenu la reconnaissance officielle de leur statut universitaire (ainsi Orléans, Angers ou Valladolid).
De la douzaine d’universités nées au xiiie siècle, les plus anciennes étaient apparues à peu près simultanément, peu avant ou peu après 1200, en quelques sites privilégiés, déjà actifs dans les décennies antérieures : Bologne, Paris, Oxford, Montpellier. Ces universités resteront, jusqu’à la fin du Moyen Âge – et bien au-delà –, les plus importantes et les plus prestigieuses universités occidentales. Leurs naissances ont été, on l’a dit, pratiquement simultanées et, si elles correspondaient donc à un contexte et des besoins analogues, elles n’en ont pas moins eu toutes leur propre histoire qui a modelé les traits spécifiques de chacune.
Dans le présent chapitre, nous commencerons par nous attarder plus spécialement sur le cas parisien, laissant au chapitre suivant l’apparition des autres premières universités européennes et les débuts du mouvement de créations plus ou moins volontaires qui en a assuré le relais dès les années 1220.
L’histoire de la naissance et des premiers développements de l’université de Paris a souvent été écrite mais n’en conserve pas moins d’importantes zones d’ombre. Les documents sont en effet peu nombreux (95 en tout dans le Chartularium pour la période 1200-1231) ; presque tous d’origine pontificale, ils ne renseignent qu’indirectement sur les motivations et les modes d’action des maîtres et étudiants parisiens eux-mêmes, dont on ne connaît même pas, le plus souvent, les noms. Plutôt qu’un récit linéaire, quelque peu artificiellement reconstitué, de la naissance de l’université de Paris, nous avons donc préféré présenter ci-dessous quatre grands textes fondateurs qui peuvent être considérés comme autant de jalons essentiels balisant ce processus historique.
Le privilège de Philippe Auguste (1200)
https://books.openedition.org/pur/21367?lang=fr#anchor-toc-1-1
Pour toutes les affaires les concernant, ils relèveraient exclusivement de la justice ecclésiastique
et ne pourraient être jetés en prison par les officiers du roi (privilège du for ecclésiastique)
Au printemps 1200, à la suite d’une rixe de taverne, quelques étudiants furent tués par des sergents du roi. Cet incident sanglant mais relativement banal témoigne à sa manière de la croissance continue des écoles parisiennes sur la rive gauche et des problèmes concrets d’ordre public qui en résultaient. Les étudiants (scholares) formaient au sein de la population un groupe de plus en plus nombreux et visible, perçu comme tel par les habitants et prenant par le fait même conscience de plus en plus aiguë de son existence et de sa spécificité. […]
Les statuts de Robert de Courson (août 1215)
https://books.openedition.org/pur/21367?lang=fr#anchor-toc-1-2
Le moment était donc venu de fixer solennellement la structure institutionnelle nouvelle
qui était désormais celle d’une véritable « université » (universitas magistrorum et scolarium Parisiensium)
Quinze ans plus tard, au terme d’une tournée que lui avait confiée le pape Innocent III dans le cadre de la préparation du quatrième concile du Latran (qui s’ouvrira le 11 novembre 1215), le cardinal-légat Robert de Courson octroya aux maîtres et écoliers de Paris une lettre par laquelle il fixait, au nom du pape, divers points relatifs au fonctionnement des écoles et à l’organisation des études. Le texte emploie, pour définir son objet, le mot, classique au Moyen Âge, de « réforme » (reformatio in melius). […]
Super speculam (16 novembre 1219)
https://books.openedition.org/pur/21367?lang=fr#anchor-toc-1-3
S’agissant de Paris qui était comme « la tour de David », l’arsenal où se forgeaient les armes des défenseurs de la foi, il serait interdit à l’avenir d’y enseigner à quelque titre que ce soit le droit romain
Malgré leur relative précision, les statuts de 1215 ne suffirent pas pour stabiliser d’un seul coup un processus encore en évolution rapide. Les maîtres et les étudiants, spécialement les plus jeunes et les plus remuants, ceux des écoles d’arts, entendaient pousser encore leur avantage, accroître leur autonomie, élargir sans contrainte la palette des enseignements nouveaux […]
Parens scientiarum (13 avril 1231)
https://books.openedition.org/pur/21367?lang=fr#anchor-toc-1-4
Texte fameux, qui sera sans cesse invoqué par la suite comme le fondement canonique de l’autonomie universitaire (la « Grande Charte » de l’université)
§ 30- La décennie 1220-1230 a vu se poursuivre l’essor de l’université de Paris. Avec la croissance des effectifs les institutions évoluaient irrésistiblement. Les étudiants, écartés de la direction même du studium, tendaient à se regrouper en « nations » selon leur origine géographique, mais la papauté s’opposa en 1222 à l’institutionnalisation de ces groupements. Même si aucun incident majeur n’est mentionné par les sources, l’évêque et le chancelier restaient hostiles à l’autonomie universitaire et le pouvoir royal, passé en 1226 aux mains de la régente Blanche de Castille, aux prises de divers côtés avec l’agitation de la noblesse et des villes, se montrait lui-même plus méfiant vis-à-vis de l’université, vue surtout comme une source possible de désordres.
C’est en effet ce qui se produisit en 1229. Comme en 1200, une simple dispute dans une taverne du faubourg Saint-Marcel tourna mal. Quelques étudiants tombèrent sous les coups des sergents. L’université demanda en vain justice et se mit bientôt en grève. Ni la régente ni l’évêque ne faisant, selon elle, droit à ses plaintes, elle passa bientôt à une solution plus radicale, la dispersion volontaire pour une durée de six ans. Maîtres et écoliers quittèrent en masse Paris, les uns pour Angers, les autres pour Orléans ; les Anglais regagnèrent leur île. À dire vrai, certains restèrent, notamment les étudiants mendiants qui profitèrent même des circonstances pour se faire octroyer par le chancelier, sans autre examen, leurs premières maîtrises.
Mais la situation créée par le départ des écoles ne pouvait manifestement durer. L’université avait pris trop d’importance, elle était trop attachée à la ville de Paris, siège depuis plus d’un siècle d’une activité scolaire exceptionnelle pour qu’une dispersion pure et simple, qui faisait disparaître les institutions universitaires comme telles, fut acceptable. Le pape, qui était maintenant Grégoire IX, s’entremit. Il représenta à la régente les inconvénients majeurs encourus par sa capitale et l’honneur même du royaume.
Il rappela à l’évêque la protection pontificale dont bénéficiaient les gens des écoles. Des arbitres furent désignés, des délégations se rendirent à Rome. Au bout de deux ans, un compromis fut finalement trouvé et le retour des exilés négocié.
Pour lui donner toute la solennité requise, le pape l’accompagna, le 13 avril 1231, de la proclamation de la bulle Parens scientiarum. Ce texte fameux, qui sera sans cesse invoqué par la suite comme le fondement canonique de l’autonomie universitaire (la « Grande Charte » de l’université), est d’abord remarquable par le ton grandiloquent de son préambule qui est un vibrant éloge de l’université, célébrant avec plus d’enthousiasme encore que Super speculam son rôle providentiel de creuset de toute bonne doctrine, rempart de la foi, pépinière de pasteurs, inspiratrice du pontife romain :
« Paris, mère des sciences [parens scientiarum], brille, chère à nos cœurs, comme une seconde Cariath Sapher, la cité des lettres ; grande assurément, elle fait attendre d’elle, généreusement, de plus grandes choses encore… C’est là qu’est extrait de la terre le minerai de fer et que, tandis qu’est affermie la fragilité terrestre, il devient le bouclier de la foi, le glaive spirituel et tout le reste de l’armure de la milice chrétienne, puissante en face des puissances aériennes »
§ 35- D’autres textes postérieurs préféreront les métaphores de la fontaine jaillissante de sagesse ou des quatre fleuves du Paradis mais le ton était donné : l’université de Paris était reconnue comme une institution majeure de la Chrétienté médiévale, une autorité intellectuelle unanimement respectée, digne à la fois d’attirer à elles les meilleurs esprits de tout l’Occident et d’exercer à l’échelle de celui-ci une sorte de magistère doctrinal, en union étroite, évidemment, avec le Siège romain.
§ 36- Pour le reste, Parens scientiarum était d’abord un appel à l’apaisement du conflit par la réconciliation de ceux qui avaient quitté Paris et de ceux qui étaient restés. Puis le pape confirmait avec une solennité particulière, en les précisant parfois, l’ensemble des libertés et privilèges acquis depuis trente ans par l’université. La procédure de collation de la licence était rappelée en détail […]
§ 38- Deux points importants étaient cependant spécifiés par le pape. D’abord, les maîtres et étudiants se voyaient reconnaître, en cas de déni de justice de la part des pouvoirs extérieurs et après préavis de quinze jours, un véritable droit de grève par suspension volontaire des leçons et disputes. Quant à l’interdiction lancée en 1215 sur l’enseignement de la philosophie naturelle, elle était renouvelée mais sous une forme mitigée. […]
§ 39- La date de 1231 peut donc bien être retenue pour marquer l’avènement de l’institution universitaire parisienne à la maturité. L’essentiel était acquis et les rôles distribués. Les maîtres eux-mêmes et leurs étudiants d’un côté, les papes de l’autre ont été les acteurs essentiels du processus. L’autonomie de l’université, qui regroupait désormais pratiquement toutes les écoles parisiennes, reposait solidement sur ses privilèges judiciaires et sur un corps de statuts qui lui permettaient d’organiser librement l’enseignement des diverses disciplines, les examens et la vie commune de ses membres. […]
§ 44- Mais il importe de souligner dès à présent que l’université de Paris a donné aux disciplines qui y étaient enseignées une assise institutionnelle incomparable. Son rayonnement s’est exercé, on l’a dit, à l’échelle de la Chrétienté. Paris est véritablement devenu au xiiie siècle un foyer majeur de débat intellectuel et de renouveau des idées. Des centaines de jeunes clercs y ont été formés, selon des méthodes sûres, aux techniques les plus raffinées du travail intellectuel. Certes, celui-ci comportait des règles parfois rigides, des hiérarchies fortement affirmées, mais la qualité de l’enseignement universitaire parisien a fait faire des progrès décisifs à l’autonomie, pour ne pas dire la professionnalisation, de la culture savante. La figure encore un peu vague des gens de savoir s’y est investie dans un type social bien précis et exceptionnellement prestigieux, celui du docteur. On comprend que l’université de Paris soit alors devenue un modèle que l’on cherchera bientôt à imiter et à reproduire partout où se fera sentir l’aspiration à une semblable promotion de la culture.
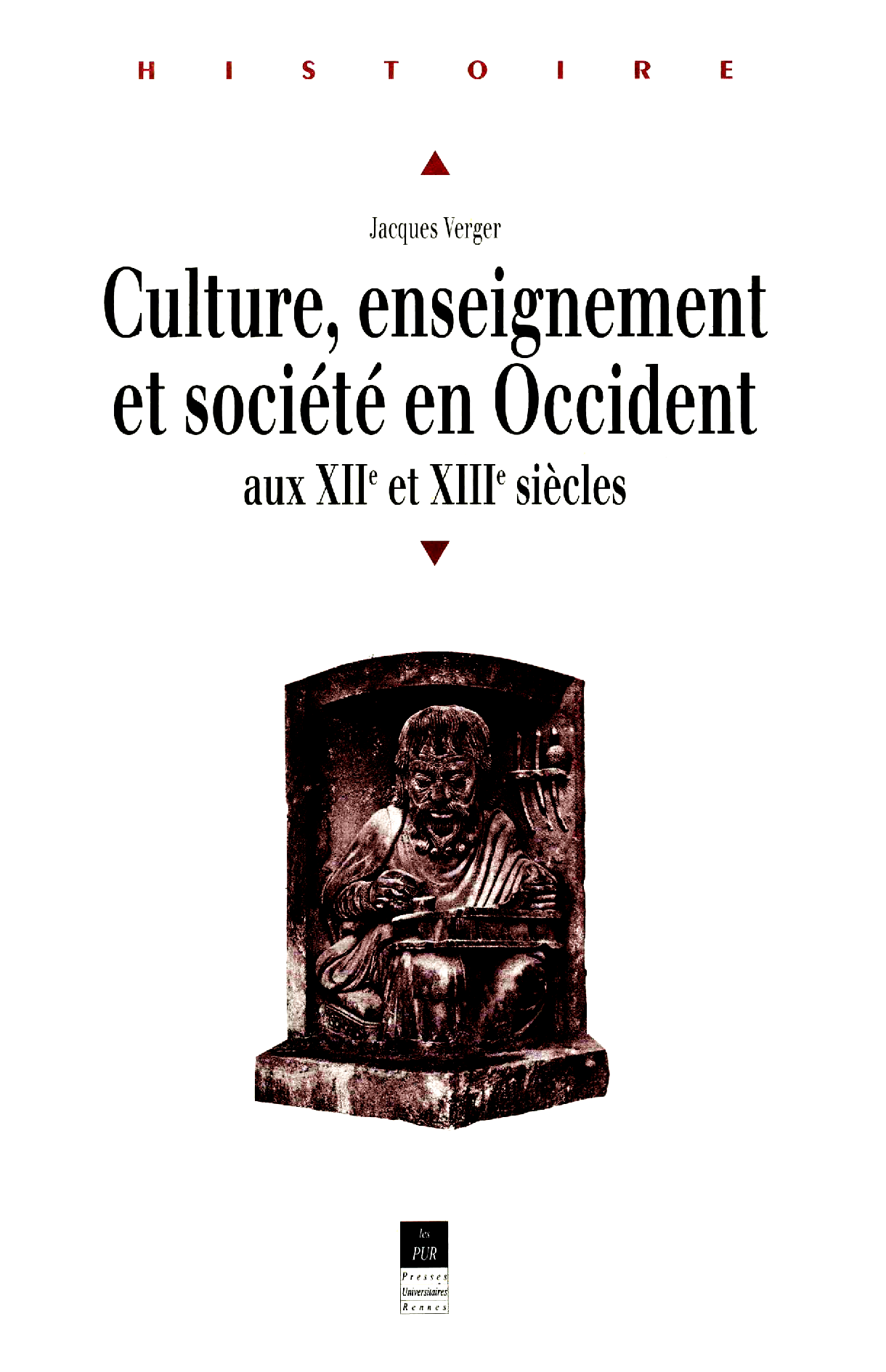

Laisser un commentaire