
Présentation
Ce livre n’est pas seulement le fruit d’un évènement circonstanciel, à savoir la question d’histoire médiévale mise au programme de l’agrégation externe en 2010-2011. Il procède d’une démarche éclairant d’un jour nouveau l’histoire du fait religieux en Occident au Moyen Âge et dont les travaux récents, attentifs aux apports méthodologiques de l’anthropologie et de la sociologie, montrent toute la fécondité. Il s’agit en un mot de comprendre comment s’articulent deux versants du christianisme médiéval : les éléments de stabilité (les « structures ») d’une part, les éléments mouvants (les « dynamiques ») d’autre part. […]
Chapitre XV. Les ordres militaires et hospitaliers : une « nouvelle religion »
Damien Carraz
p. 179-193
Extrait
Référence électronique du chapitre
https://books.openedition.org/pur/131175
Formés à partir d’une confrérie de chevaliers champenois et bourguignons, les Templiers ont inspiré toutes les fondations qui suivirent en montrant notamment la voie de la militarisation à des confréries charitables

PREMIÈRES PAGES
Nova religio : c’est le terme employé par plusieurs auteurs de la seconde moitié du XIIe siècle pour rendre compte de la nouveauté spirituelle incarnée par l’ordre du Temple. Nés sur les frontières de la chrétienté, dans un contexte de confrontation avec l’Islam ou le paganisme, les ordres religieux militaires ont offert aux laïcs, hommes et femmes, la possibilité de faire leur salut sans renoncer à leur état dans le siècle. Alors que l’association du bellator et de l’orator bousculait l’ordre social hérité de la tripartition carolingienne, ces « nouvelles milices » qui ne relevaient strictement ni de l’ordo monasticus, ni de l’ordo canonicus, ont déconcerté théologiens et canonistes en brouillant les catégories de la vie religieuse. Aussi le caractère inédit de ce nouveau propositum vitae suscita-t-il parfois le scepticisme de moines habitués aux états de vie bien tranchés – ainsi le clunisien Pierre le Vénérable ou le chartreux Guigues – voire la franche hostilité du cistercien Isaac de l’Étoile vitupérant contre ce « monstre nouveau » qui souillait l’idéal monastique en répandant le sang. Mais la diffusion du modèle de l’ordre religieux militaire à travers toute la chrétienté latine, comme son succès immédiat auprès des fidèles, prouve que celui-ci répondait bien à une attente spirituelle et aux impératifs stratégiques de la guerre sainte. Acteurs déterminants de l’histoire des croisades et de la Reconquista, les principaux ordres continuèrent à accomplir, aux XIVe et XVe siècles, leur mission initiale en Méditerranée (Hôpital), sur les marges orientales de l’Europe (Teutoniques) ou en péninsule Ibérique. Toutefois, cet aspect primordial est délaissé dans ce chapitre où l’on préfère présenter les « structures et dynamiques religieuses » de ces institutions, qui furent longtemps considérées comme de simples corporations guerrières et seigneuriales, mais dont on commence enfin à saisir l’impact sur les mutations ecclésiologiques du Moyen Âge central. […]
Des pieuses associations fraternelles aux puissantes congrégations
Des chemins de pèlerinage aux frontières de la chrétienté
Formés dans l’orbite du chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem à partir d’une confrérie de chevaliers champenois et bourguignons, les Templiers ont reçu leur règle au concile de Troyes en 1129. Ils ont inspiré toutes les fondations qui suivirent en montrant notamment la voie de la militarisation à des confréries charitables : l’hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, apparu dans le contexte de la première croisade, s’engagea dans les combats en Terre sainte et dans la péninsule Ibérique dès les années 1130-1140, tout comme l’hôpital Sainte-Marie des Teutoniques – né à Acre vers 1190, militarisé huit ans plus tard – et Saint-Lazare – issu d’une léproserie attestée à Jérusalem vers 1130 et impliqué dans la croisade un siècle plus tard. Opérée sous l’influence du Temple, cette conversion militaire fut également encouragée par les souverains de Terre sainte et de la péninsule Ibérique désireux d’impliquer ces puissances nouvelles dans la défense de leurs États. Parallèlement aux expériences de Terre sainte, mais cette fois-ci sur le front de la Reconquista, des confréries de chevaliers encadrées par les Cisterciens se formèrent pour défendre et peupler villes et territoires devenus chrétiens. Celles-ci donnèrent naissance à des ordres militaires marqués par une empreinte « nationale » : Calatrava fut fondamentalement castillan, le contrôle d’Alcántara fut un enjeu entre Castille et León, Santiago fut plutôt proche de la monarchie castillane, mais donna naissance à une branche portugaise indépendante en 1290, tandis qu’Avis fut spécifiquement portugais. À l’autre extrémité de la chrétienté, dans le premier tiers du XIIIe siècle, la spiritualité militante de Cîteaux donna de même naissance aux milices des Porte-Glaive et de Dobrin, chargées de soutenir l’évangélisation des confins baltes. Malgré leur diversité, ces ordres partagent une origine commune : ils sont issus d’associations de chevaliers attachés à la défense d’une ville ou d’un château et patronnés par une institution canoniale ou monastique. Ce creuset confraternel, conforme à l’esprit évangélique mais enrichi d’une dimension militaire, constitua l’essence spirituelle du monachisme militaire. Au XIIIe siècle, il continua d’inspirer des confréries armées dédiées à la lutte contre l’hérésie et au contrôle des mœurs, soutenues par les Dominicains en Italie du Nord – milices de Jésus-Christ et de la Vierge Marie – ou par les légats pontificaux en Languedoc – milices de la Foi de Jésus-Christ et de la Foi et de la Paix.
Les congrégations hospitalières découlent de la même démarche : un petit groupe de pieux laïcs, mus par une volonté d’engagement dans le monde et attachés à un sanctuaire, finit par se transformer en ordre religieux. Caractéristique est la fondation des Antonins à partir d’une communauté hospitalière installée à La Motte-aux-Bois, en Dauphiné, auprès d’une église qui conservait les reliques de saint Antoine depuis les années 1070. Les frères accueillaient les pèlerins et se consacrèrent surtout aux victimes du « mal des ardents », une forme d’ergotisme qui fit des ravages entre les XIe et XIVe siècles. Ces congrégations se sont engagées dans le soin et l’accueil de tous les nécessiteux et déracinés – pèlerins, enfants abandonnés, lépreux, malades… –, mais certaines se spécialisèrent dans certaines formes d’entraide. Dans les régions de frontière où sévissait la piraterie sarrasine, comme le Midi de la France et la péninsule Ibérique, les ordres dits « rédempteurs » se consacrèrent au rachat des chrétiens captifs en terre d’Islam. Fondés à la suite de la troisième croisade, les Trinitaires se développèrent essentiellement dans les grandes cités maritimes du Midi (Arles, Marseille, Narbonne), de Catalogne et d’Italie, tandis que les Mercédaires apparurent autour de 1230 lors de la conquête de Majorque par le roi Jacques Ier d’Aragon. Tout en gérant des hôpitaux traditionnels, ces ordres développèrent notamment leur activité en Afrique du Nord, plaque tournante du trafic esclavagiste. Il faut enfin mentionner les dizaines de pieuses confréries laïques affectées à la gestion d’un pont ou d’une maison d’accueil sur une route et dont certaines connurent une postérité remarquable au point de se transformer en véritable congrégation. C’est le cas de San Jacopo d’Altopascio, né d’un hôpital attesté dès l’époque carolingienne sur la via Francigena, dans le diocèse de Lucques.
Vers l’institutionnalisation
L’institutionnalisation de ces regroupements suivit un processus similaire qui passa souvent par la rupture avec la communauté régulière qui avait d’abord accueilli la fraternité. Cette conquête de l’autonomie s’appuya sur la papauté dont la bienveillance et l’autorité furent décisives dans la transformation d’un groupe parfois confus de pieuses personnes en véritable ordre doté d’une règle. Ainsi, les Antonins parvinrent à se libérer de la tutelle de l’abbé de Montmajour qui pesait sur le prieuré de la Motte-aux-Bois à Saint-Antoine-en-Viennois : Innocent IV leur imposa la règle de saint Augustin en 1247 puis, en 1297, Boniface VIII érigea le prieuré de Saint-Antoine en abbaye chef d’un ordre indépendant de chanoines réguliers. L’obtention de privilèges pontificaux entérinait le processus d’institutionnalisation : les grands ordres militaires jouirent de la forme la plus achevée de l’exemption, mais les autres institutions bénéficièrent aussi de libertés importantes : protection spéciale du Saint-Siège, octroi de leurs propres églises et cimetières, administration des sacrements aux membres de la familia et aux malades, libre exercice de la quête, parfois affranchissement de l’interdit, etc. Outre son action en faveur de la croisade, le pontificat d’Innocent III représenta un tournant pour plusieurs congrégations puisqu’il donna une règle aux ordres du Saint-Esprit et de la Trinité (1198), confirma la double mission des Teutoniques (1199) et reconnut les Porte-Glaive (1204). Théoriquement indépendants des pouvoirs locaux, les ordres internationaux servirent pleinement les projets centralisateurs et réformateurs de la papauté : ils participèrent à l’encadrement ecclésiastique des fidèles et même du clergé – au XIIIe siècle, plusieurs monastères bénédictins en crise furent par exemple confiés au Temple en Italie – et ils fournirent des cadres au gouvernement pontifical – ambassadeurs, collecteurs de taxes, offices militaires… –, même s’ils hésitèrent à s’engager dans les croisades trop politiques dirigées contre d’autres chrétiens.
Malgré leur nouveauté, les institutions militaro-hospitalières ne donnèrent pas naissance à de nouvelles règles, conformément au concile de Latran IV qui avait limité le foisonnement de la vie religieuse. Seuls des statuts, souvent révisés et augmentés, conféraient une personnalité propre à chaque institution dont les fondements normatifs reposèrent sur l’une des deux grandes traditions du monachisme occidental. Appropriée à une vie active dans le siècle, la règle dite de saint Augustin fut adoptée par l’Hôpital, Saint-Lazare, Santiago, la plupart des ordres hospitaliers. Mais cela n’en faisait pas pour autant des ordres de chanoines réguliers, à l’exception des Antonins. Seconde tradition monastique : la règle de saint Benoît. Adaptée à la mission militaire, elle fut proposée au Temple et aux ordres hispaniques encadrés par Cîteaux – Calatrava, Alcántara, Avis. Là encore, ce choix ne permet pas d’assimiler pleinement à des moines ces frères guerriers qui rompaient franchement avec certains principes monastiques, non seulement par l’intégration de l’homicide, mais encore par le rejet de la stabilitas. À l’instar des Trinitaires, dont le mode de vie reposait sur l’itinérance, les missions guerrières et d’assistance imposaient aux frères des déplacements permanents à plus ou moins grande échelle et, parfois, un déracinement jusque dans la mort, puisqu’ils pouvaient être inhumés hors de leurs propres établissements. Bref, à l’image des Templiers, dont la règle était d’inspiration bénédictine mais qui suivaient la liturgie canoniale du Saint-Sépulcre, ces ordres cultivaient l’ambiguïté. Juridiquement et socialement, les frères des ordres militaires et hospitaliers n’en étaient pas moins reconnus comme des religieux.
Une organisation administrative inédite
Soutenus par les pouvoirs seigneuriaux, princiers et monarchiques – notamment en péninsule Ibérique –, enrichis par les donations des fidèles, le Temple et l’Hôpital furent les premières institutions régulières à investir l’ensemble de la chrétienté latine, de la Terre sainte à l’Occident. Outre l’Orient latin, les Teutoniques s’établirent surtout dans l’espace germanique et dans le sud de l’Italie. L’action des ordres ibériques s’exerça essentiellement dans le cadre des royaumes péninsulaires, même si on a pu souligner leur présence diffuse sur d’autres terrains, comme la Terre sainte ou l’Italie. À quelques exceptions près, comme les Antonins, les ordres hospitaliers eurent surtout un rayonnement régional. Ainsi, au début du XIVe siècle, les Mercédaires détenaient une soixantaine de maisons disséminées dans la Couronne d’Aragon, en Castille, au Portugal et en Languedoc. Saint-Lazare réunit un temporel dispersé dans quelques contrées, par exemple autour de Burton Lazars, en Angleterre, de Seedorf, en Suisse, ou de Boigny, dans le Loiret. Chaque institution connut bien sûr un rythme de développement propre, mais l’on peut considérer qu’au milieu du XIIIe siècle, les temporels et les structures gouvernementales étaient fixés dans leurs grandes lignes.
À partir de la Terre sainte où ils installèrent leurs quartiers généraux – qui migrèrent au gré du contexte géopolitique, de Jérusalem à Acre, jusqu’à Chypre –, les ordres internationaux durent mettre en place une organisation administrative adaptée à une expansion inédite à l’échelle de la chrétienté latine. Bien avant les ordres mendiants, la division en provinces (Temple), prieurés (Hôpital) ou baillies (Teutoniques), une hiérarchie administrative complexe et des instruments de contrôle – chapitres généraux et provinciaux, visites – permirent de maintenir la liaison entre le couvent central, composé du grand-maître et des hauts officiers, et l’arrière reposant sur la trame des commanderies. Si ces découpages étaient indépendants des structures territoriales de l’Église et ne coïncidaient pas forcément avec les frontières politiques, ces ordres furent néanmoins soucieux de préserver une certaine cohérence linguistique et culturelle. La répartition en langues que l’Hôpital surimposa à la division territoriale à partir du XIVe siècle trouve par exemple son équivalent dans l’organisation en quatre nations – française, allemande, italienne, espagnole – représentées à l’abbaye chef de Saint-Antoine depuis 1420.
Loin des complexes urbains ou castraux de Terre sainte, de la péninsule Ibérique ou de Prusse qui accueillaient les couvents centraux et les principales garnisons, le lieu de vie essentiel des frères en Occident était la commanderie. Le terme de preceptoria/comendaria – qui apparaît plutôt au XIVe siècle, la documentation préférant l’idée générale de domus, maison – regroupe plusieurs réalités. C’est d’abord un microcosme humain, composé de religieux, de familiers et d’affiliés laïques, réunis sous l’autorité d’un commandeur. À la différence des monastères traditionnels, une commanderie moyenne n’était guère peuplée de plus d’une dizaine de frères car, à la concentration de leurs effectifs dans d’importants couvents, les milices ont préféré un essaimage d’établissements modestes mais quadrillant parfaitement le territoire. Une commanderie est également une réalité juridictionnelle et matérielle : c’est l’ensemble d’un temporel et de droits seigneuriaux et spirituels divers organisés à partir de dépendances – granges, églises, maisons annexes… – régies par une maison mère. Enfin, selon l’acception la plus courante mais souvent dévoyée, la commanderie peut aussi désigner une réalité monumentale, c’est-à-dire l’habitat d’une communauté religieuse comportant des espaces de vie commune – réfectoire, dortoir, cloître parfois –, un lieu de culte, des annexes économiques et quelquefois un lieu d’accueil. Même si leur rayonnement fut plus modeste, les congrégations hospitalières, à l’instar des Antonins ou des Mercédaires, adoptèrent une organisation comparable en commanderies (ou préceptories) regroupées en provinces. Altopascio établit également un réseau de dépendances, appelées obedientiæ, le long des voies de pèlerinage dans de nombreuses régions d’Europe. Les principaux ordres militaires inspirèrent donc les institutions d’assistance jusque dans leur organisation interne : les usages du Temple et de l’Hôpital déterminèrent ceux de Saint-Lazare et des Teutoniques, tandis qu’Altopascio et le Saint-Esprit reçurent les statuts de l’Hôpital.
Auteur
Damien Carraz
MCF, université de Clermont-Ferrand II
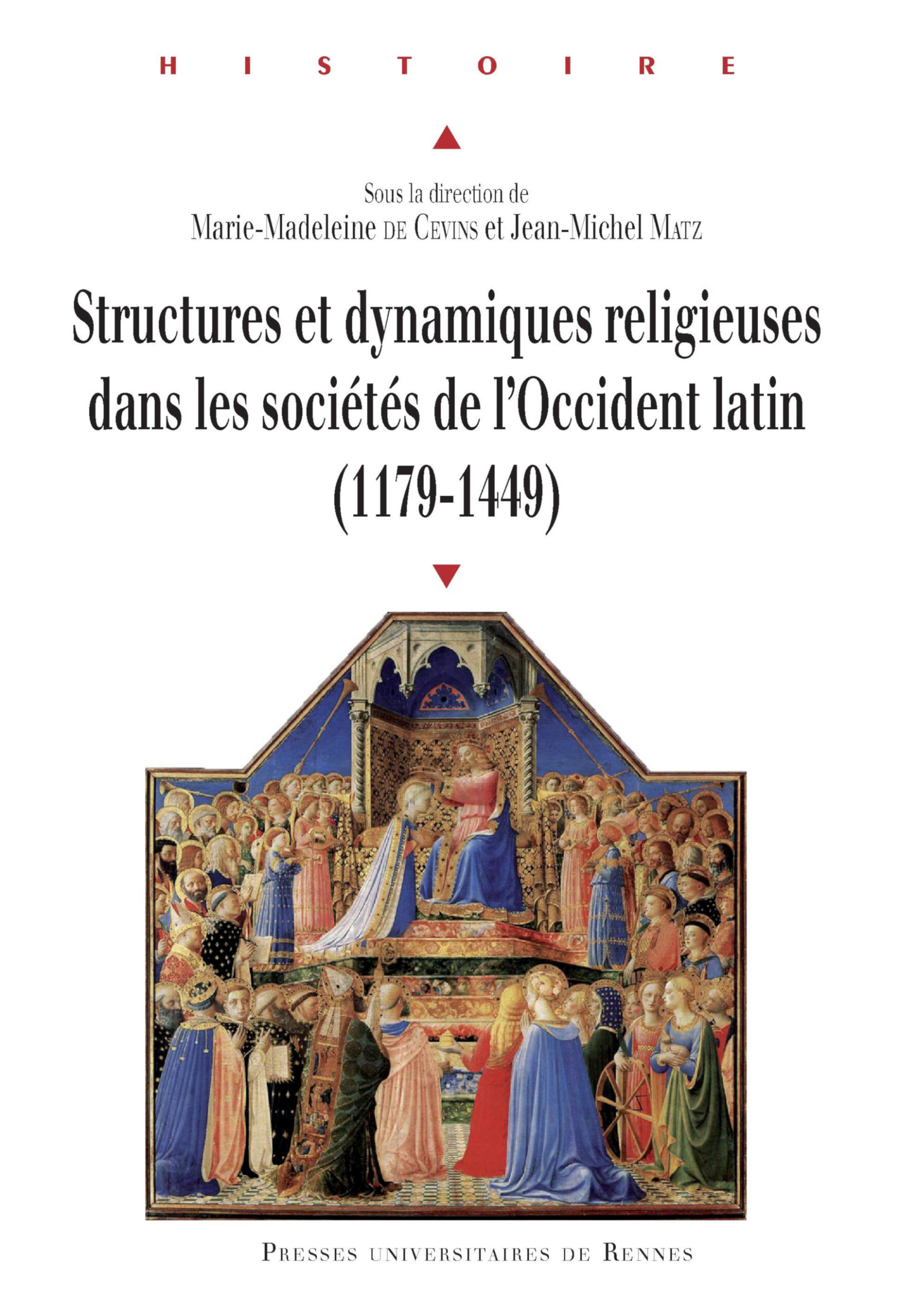

Laisser un commentaire